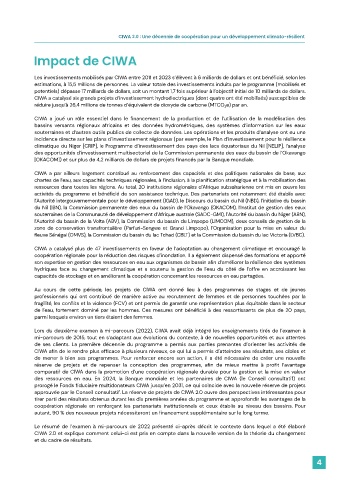Page 9 - CIWA 2.0
P. 9
CIWA 2.0 : Une décennie de coopération pour un développement climato-résilient
Impact de CIWA
Les investissements mobilisés par CIWA entre 2011 et 2023 s’élèvent à 6 milliards de dollars et ont bénéficié, selon les
estimations, à 15,5 millions de personnes. La valeur totale des investissements induits par le programme (mobilisés et
potentiels) dépasse 17 milliards de dollars, soit un montant 1,7 fois supérieur à l’objectif initial de 10 milliards de dollars.
CIWA a catalysé six grands projets d’investissement hydroélectriques (dont quatre ont été mobilisés) susceptibles de
réduire jusqu’à 26,4 millions de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (MTCO e) par an.
2
CIWA a joué un rôle essentiel dans le financement de la production et de l’utilisation de la modélisation des
bassins versants régionaux africains et des données hydrométriques, des systèmes d’information sur les eaux
souterraines et d’autres outils publics de collecte de données. Les opérations et les produits d’analyse ont eu une
incidence directe sur les plans d’investissement régionaux (par exemple, le Plan d’investissement pour la résilience
climatique du Niger [CRIP], le Programme d’investissement des pays des lacs équatoriaux du Nil [NELIP], l’analyse
des opportunités d’investissement multisectoriel de la Commission permanente des eaux du bassin de l’Okavango
[OKACOM]) et sur plus de 4,2 milliards de dollars de projets financés par la Banque mondiale.
CIWA a par ailleurs largement contribué au renforcement des capacités et des politiques nationales de base, aux
chartes de l’eau, aux capacités techniques régionales, à l’inclusion, à la planification stratégique et à la mobilisation des
ressources dans toutes les régions. Au total, 20 institutions régionales d’Afrique subsaharienne ont mis en œuvre les
activités du programme et bénéficié de son assistance technique. Des partenariats ont notamment été établis avec
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Discours du bassin du Nil (NBD), l’initiative du bassin
du Nil (IBN), la Commission permanente des eaux du bassin de l’Okavango (OKACOM), l’Institut de gestion des eaux
souterraines de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC-GMI), l’Autorité du bassin du Niger (ABN),
l’Autorité du bassin de la Volta (ABV), la Commission du bassin du Limpopo (LIMCOM), deux conseils de gestion de la
zone de conservation transfrontalière (Parfuri-Sengwe et Grand Limpopo), l’Organisation pour la mise en valeur du
fleuve Sénégal (OMVS), la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) et la Commission du bassin du lac Victoria (LVBC).
CIWA a catalysé plus de 47 investissements en faveur de l’adaptation au changement climatique et encouragé la
coopération régionale pour la réduction des risques d’inondation. Il a également dispensé des formations et apporté
son expertise en gestion des ressources en eau aux organismes de bassin afin d’améliorer la résilience des systèmes
hydriques face au changement climatique et a soutenu la gestion de l’eau du côté de l’offre en accroissant les
capacités de stockage et en améliorant la coopération concernant les ressources en eau partagées.
Au cours de cette période, les projets de CIWA ont donné lieu à des programmes de stages et de jeunes
professionnels qui ont contribué de manière active au recrutement de femmes et de personnes touchées par la
fragilité, les conflits et la violence (FCV) et ont permis de garantir une représentation plus équitable dans le secteur
de l’eau, fortement dominé par les hommes. Ces mesures ont bénéficié à des ressortissants de plus de 20 pays,
parmi lesquels environ un tiers étaient des femmes.
Lors du deuxième examen à mi-parcours (2022), CIWA avait déjà intégré les enseignements tirés de l’examen à
mi-parcours de 2015, tout en s’adaptant aux évolutions du contexte, à de nouvelles opportunités et aux attentes
de ses clients. La première décennie du programme a permis aux parties prenantes d’orienter les activités de
CIWA afin de le rendre plus efficace à plusieurs niveaux, ce qui lui a permis d’atteindre ses résultats, ses cibles et
de mener à bien ses programmes. Pour renforcer encore son action, il a été nécessaire de créer une nouvelle
réserve de projets et de repenser la conception des programmes, afin de mieux mettre à profit l’avantage
comparatif de CIWA dans la promotion d’une coopération régionale durable pour la gestion et la mise en valeur
des ressources en eau. En 2024, la Banque mondiale et les partenaires de CIWA (le Conseil consultatif) ont
prorogé le Fonds fiduciaire multidonateurs CIWA jusqu’en 2031, ce qui coïncide avec la nouvelle réserve de projets
approuvée par le Conseil consultatif. La réserve de projets de CIWA 2.0 ouvre des perspectives intéressantes pour
tirer parti des résultats obtenus durant les dix premières années du programme et approfondir les avantages de la
coopération régionale en renforçant les partenariats institutionnels et ceux établis au niveau des bassins. Pour
autant, 90 % des nouveaux projets nécessiteront un financement supplémentaire sur le long terme.
Le résumé de l’examen à mi-parcours de 2022 présenté ci-après décrit le contexte dans lequel a été élaboré
CIWA 2.0 et explique comment celui-ci est pris en compte dans la nouvelle version de la théorie du changement
et du cadre de résultats.
4