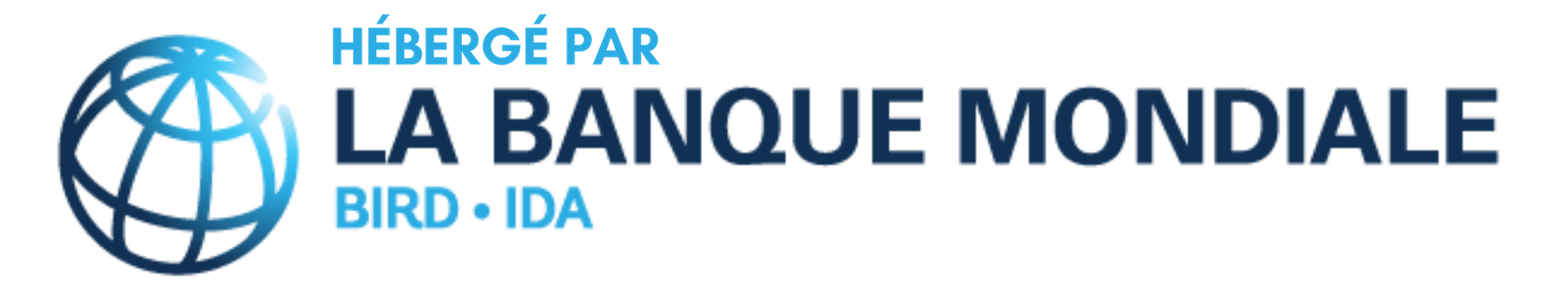Protéger les eaux souterraines de l'épuisement dans le SMAB
Posté le : 5 mai 2025 (Vue du terrain)

Landing Bojang collecte et surveille des données sur l'eau dans le bassin aquifère sénégalo-mauritanien. ©Landing Bojang
Le débarquement de Bojang est préoccupant.
"Si les prélèvements d'eau souterraine sont excessifs et inférieurs au niveau du fleuve, explique Bojang, le fleuve s'assèchera, ce qui sera catastrophique pour les écosystèmes, la biodiversité et tous les services qu'ils fournissent. M. Bojang, hydrologue en chef du département des ressources en eau du ministère gambien de la pêche, des ressources en eau et des questions relatives à l'Assemblée nationale, ajoute : "C'est dire à quel point le bassin est critique."
Le bassin sur lequel il se concentre est le bassin aquifère sénégalo-mauritanien (SMAB), partagé par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. CIWA soutient la création d'une feuille de route pour le développement d'une vision et d'un programme communs afin d'établir une coopération à long terme sur le SMAB, qui devrait aboutir à une charte régissant sa gestion.
"L'exploitation excessive des eaux souterraines est déjà un sujet de préoccupation", explique M. Bojang. "Le principal problème est que nous ne disposons pas de données sur les prélèvements d'eau souterraine.
Nous ne respectons pas nos obligations en matière de Objectifs de développement durable, en particulier l'indicateur 6.4.2Nous ne disposons pas d'informations sur les secteurs qui utilisent l'eau, qu'il s'agisse de l'usage domestique, commercial, industriel ou agricole. "Nous ne disposons pas d'informations sur les secteurs qui utilisent l'eau, qu'il s'agisse d'un usage domestique ou d'un usage commercial, industriel ou agricole."
Sauvegarder les eaux souterraines pour que les pays puissent se développer
Bojang, 40 ans, croit passionnément à l'importance des ressources en eau et à leur contribution au développement socio-économique de son pays, ce qui l'a amené à se spécialiser en hydrologie à l'université.
Il a obtenu sa licence en hydrologie et en ingénierie des ressources en eau en 2013 à l'université d'Amsterdam. Université de Hohai à Nanjing, Chine et son diplôme de maîtrise en gestion des ressources en eau en 2018 à l'Institut de recherche de l'Union européenne. IHE Delft Institute for Water Education (Institut de Delft pour l'éducation à l'eau) aux Pays-Bas.
"L'eau est fondamentale pour le développement socio-économique, et l'accès à l'eau est donc essentiel", explique-t-il. "Les eaux souterraines qui se trouvent sous nos pieds sont une ressource cruciale, et elles peuvent fournir de l'eau à des communautés éloignées avec moins d'investissements. Elles soutiennent l'écosystème et maintiennent le débit de la rivière parce qu'il y a une connectivité".
Et, dit-il, parce que le SMAB recoupe le bassin des fleuves Gambie et Sénégal, "c'est encore plus critique".
"Avec la crise imminente du changement climatique, la salinisation des rivières va s'accentuer, ce qui affectera également les eaux souterraines et accélérera l'intrusion d'eau salée dans les aquifères côtiers."
En outre, M. Bojang se dit très préoccupé par les effets de la pollution et de l'insuffisance des services d'assainissement sur la qualité des ressources en eau. "Nous avons besoin de politiques efficaces pour réglementer l'assainissement afin d'éviter la pollution des eaux souterraines", ainsi que d'une sensibilisation des communautés.
Par exemple, il explique que certaines personnes placent des matériaux imperméables, tels que des tuiles en béton, sur le sol des espaces publics tels que les complexes familiaux, ce qui empêche les précipitations de recharger les nappes phréatiques.
"Nous avons besoin de sensibiliser le public, de lois, de règlements et de capacités institutionnelles pour pouvoir gérer et gouverner les eaux souterraines", déclare-t-il.
Un changement de cap pour la région
Au cours des quatre dernières années, Bojang a été membre du Groupe de travail régional (GTR) chargé d'élaborer un accord de coopération SMAB signé par les quatre pays. Le GTR est hébergé au secrétariat du SMAB, créé par les deux organismes de bassin régionaux : l'Autorité de développement du bassin du fleuve Sénégal (OMVS), qui comprend le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), qui comprend la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. L'Observatoire du Sahara et du Sahel est également membre du GTR, tandis que la Guinée et le Mali ont le statut d'observateur.
Selon M. Bojang, le RWG a accompli beaucoup de choses, notamment la production de rapports de connaissances sur l'étendue de la recharge de l'aquifère, l'examen de différents systèmes de gestion de l'aquifère et l'étude des capacités institutionnelles, de la disponibilité des données et des protocoles de partage des données.
Il n'est pas surprenant que la coopération n'ait pas toujours été facile. Il a fallu du temps, par exemple, pour que les pays du bassin se mettent d'accord sur la dotation en personnel du secrétariat. "Tout le monde voulait une part équitable des bénéfices de la coopération - c'est la nature humaine", explique-t-il. Mais le groupe de travail régional a persévéré et les hauts-commissaires des deux organisations régionales de bassin ont signé un protocole opérationnel en octobre 2023.
En plus de la Coopération internationale Eaux en Afrique (programme CIWA), le travail du groupe de travail a été facilité par la Centre de l'eau de Genèveles Secrétariat de la Convention sur l'eau assuré par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europeet le Centre international d'évaluation des ressources en eaux souterraines. Les Union européenneles Agence suisse pour le développement et la coopérationles Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)les Agence italienne de coopération au développementet L'UNESCO financent également des projets.
Bojang se dit reconnaissant pour CIWALe soutien de la Commission européenne a permis d'évaluer la capacité des États membres et des deux organismes de bassin à gérer le SMAB et à développer le cadre institutionnel pour la gestion de l'aquifère.
"Nous sommes très heureux de bénéficier du soutien de la Commission européenne. Banque Mondiale afin que nous puissions améliorer la gestion et la durabilité des eaux souterraines", déclare M. Bojang. "Il s'agit de notre avenir et de celui des générations futures. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces eaux souterraines à cause de la pollution ou de la surexploitation. Nous devons mettre un terme à l'épuisement de cet aquifère. Avec le soutien de la Banque mondiale, c'est un changement de donne pour la région".